
Oui, je me souviens
La recrudescence du nazisme à travers le monde, l'incroyable dénégation de l'holocauste à laquelle nous assistons actuellement, posent à l'ancien déporté de graves problèmes.

Cet article a été publié en 1979 par le Département de l'éducation et de la culture par la Tora dans la Diaspora de l'Organisation Sioniste Mondiale. Elle faisait partie de la collection "OUI", publiée à l'initiative et sous la direction du rabbin Jean Schwarz.
À Jeanine Bloch qui a assumé tant de risques lors de mon arrestation et qui est devenue ma femme
Un témoignage
Qu'est-ce qui me pousse, 33 ans après, à prendre la plume et à me replonger dans mes souvenirs ?
Lorsque le Directeur de cette publication m'a demande de rédiger un “OUI” sur un tout autre sujet, pourquoi lui ai-je proposé celui-ci ? Toute réaction spontanée est intéressante à étudier a posteriori.
Quelques mauvaises journées et quelques mauvaises nuits passées récemment à la suite d'une opération, subie cependant dans des conditions d'hospitalisation et de soins parfaits, m'ont fait penser à celles passées en automne 1944 au K.B., l'infirmerie du camp de Gleiwitz, l'un des camps annexes d'Auschwitz. Malgré l'équipement rudimentaire et notamment l'absence de médicaments élémentaires, le médecin, lui aussi déporté, s'était efforcé de sauver mon médius droit atteint d'un vilain phlegmon. En définitive, il dut l'amputer, bien entendu sans anesthésie.
Apres quelques jours, alors que toute ma main était encore engourdie, mes doigts raides comme paralysés, d'une heure à l'autre, il me mit à la porte du K.B. et me renvoya dans mon bloc. Le risque était énorme : incapable de travailler, je me trouvais repéré par les kapos, par les S.S. et mûr pour la prochaine sélection générale.
Je lui en voulus terriblement, jusqu'au lendemain où j'appris que le soir même, il y avait eu une sélection spéciale au K.B., que le médecin avait été prévenu et que le seul moyen d'essayer de me sauver avait été de me faire sortir du K.B. Si j'y avais été, je partais irrévocablement à la chambre à gaz. Mais ce récent passage à l'hôpital n'explique pas entièrement ce besoin subit et curieux que j'éprouve d'affirmer et de prouver que je n'ai pas oublié.
La recrudescence du nazisme à travers le monde, l'incroyable dénégation de l'holocauste à laquelle nous assistons actuellement, posent à l'ancien déporté de graves problèmes. J'ai vu de mes propres yeux, j'ai souffert dans ma propre chair, je me souviens comme si c'était hier et je me tais ?
Je suis un témoin, un des rares témoins, et je ne réagis pas ? Que sera-ce le jour où il n'y aura plus de témoins oculaires ? Et ce jour arrive à grands pas. Alors ils s'en donneront à cœur-joie pour nier et, aux jeunes générations forcement sceptiques devant l'énormité du phénomène, ils n'auront pas de mal à insuffler le doute et l'idée d'exagération.
Oui, sans doute avons-nous eu tort, anciens déportés, de nous taire, de faire preuve de tant de discrétion, de pudeur. Nous avons laissé trop souvent d'autres, qui n'ont pas connu la vie concentrationnaire, en parler, s'en servir, en abuser. Nous nous sommes laissés absorber par tous ceux qui se proclament "la génération d'Auschwitz" ou encore "les contemporains" ou "les témoins de la Shoah", alors qu'ils n'ont pas eu cette connaissance directe et complète que seule la vie de tous les jours au camp pouvait donner.
Nous avons laissé se développer toute une littérature de fiction et toute une œuvre cinématographique romancée qui ont dénaturé l'événement et ont encore ajouté à l'incompréhension générale.
Parce qu'il y a, en réalité, à l'origine, au très-profond de notre silence, la certitude que nous avons, que notre épreuve est incommunicable et que personne ne la comprendra jamais vraiment. Je me souviens fort bien qu'au début, après mon retour, j'ai loyalement essayé. J'ai participé à des dizaines de manifestations, j'ai parlé d'innombrables fois en public et j'en ai tiré, non le sentiment, mais la certitude d'une impossibilité de communication.
Ce soir, 33 ans après, je prends la plume, non pas pour raconter ma vie au camp, mais pour affirmer que je me souviens, que je me suis souvenu sans cesse pendant toutes ces années ; pour montrer, peut-être pour vérifier pour moi-même, ce dont je me souviens essentiellement, après que tant d'années se soient écoulées, que tant d'événements nouveaux se soient succédés. Peut-être puis-je apporter par-là, par mon témoignage, par une réflexion sur l'essentiel, par ce qui demeure dans mon esprit, ma modeste contribution à l'authentification d'une histoire que l'on cherche à flouer ou pour le moins à oublier.
Peut-être aussi, puis-je inciter le lecteur à réfléchir, au moment où la violence et la torture sévissent à nouveau dans tant de pays, à notre responsabilité individuelle et collective. Enfin, peut-être qu'en proclamant que je me souviens depuis Israël où ma longue route à travers Auschwitz m'a tout naturellement mené, puis-je clamer ma certitude que l'existence et le rayonnement de l'État d'Israël constituent le meilleur, en réalité le seul moyen d'empêcher un nouvel Auschwitz.
Je fais cet effort de retour en arrière avec une totale franchise, sans calcul et sans précaution. Je voudrais qu'il constitue un témoignage direct et sincère, que le lecteur sente le "vécu", sans fard et sans pudeur. Le sujet est trop grave et l'occasion trop rare pour les gâcher de quelque façon que ce soit.
La Faim et la Foi
Oui, je me souviens de cette carotte que le Grand-Rabbin René Hirschler – que sa mémoire soit bénie – m'apporta dès mon arrivée à Auschwitz. Il faisait partie d'un kommando extérieur et avait pu s'en procurer quelques unes. Le geste m'émut, mais, fraîchement arrivé, je ne l'appréciai pas à sa juste valeur. Combien de fois, plus tard, ai-je pensé à cette carotte, l'unique que j'ai mangée pendant toute ma déportation.
Je compris, par la suite, qu'en me l'offrant, spontanément, avec son large, son chaud, son beau sourire, René Hirschler m'offrait ce qu'il avait de plus précieux; bien mieux, c'était un peu de son propre courage, de sa confiance, de sa foi qu'il voulait m'insuffler et surtout, quelle leçon, quel exemple il donnait au milieu de cette jungle, régie par la folie, la violence et la faim !
Oui je me souviens d'avoir eu faim, non pas une faim ordinaire, sporadique, mais une faim d'une intensité insupportable, une faim permanente et obsédante. La souffrance qui en résultait dominait entièrement mon corps et mon esprit au point que tout le reste devenait secondaire.
Cette faim était ma première pensée à mon réveil, la dernière avant de m'endormir; elle interrompait plusieurs fois mon sommeil la nuit, malgré l'extrême fatigue ; elle accaparait toutes mes pensées au cours de la journée; elle empêchait toute autre réflexion. Impossible de me concentrer sur n'importe quel autre sujet; impossible de m'évader de cette idée-fixe : comment trouver quelque chose à manger, comment obtenir du "rab", comment manœuvrer pour arriver à être servi en fin de bidon alors que la soupe était plus épaisse ; telles étaient mes préoccupations !
J'avais beau me raisonner, essayer de m'habituer, me leurrer moi-même en avalant lentement ma soupe ou encore en coupant ma ration de pain en fines lamelles : rien n'y fit.
Et pourtant cette faim toute-puissante constituait un baromètre qui ne trompait pas ; elle permettait de mesurer la réelle capacité de résistance de l'individu, physique et morale.
C'était dans la mesure où le déporté résistait à un complet avilissement qu'on pouvait déceler ses possibilités de survie ; lorsqu'il était encore capable de ne pas se jeter à terre pour lécher à même le sol la soupe renversée par un kapo sadique, lorsqu'il était capable de rejeter toute compromission avec certains kapos malgré les promesses alléchantes de nourriture, lorsqu'il arrivait à faire, de temps en temps, le geste héroïque de donner un peu de sa soupe épaisse à un camarade mal servi, alors on savait, et il le ressentait, qu'il était encore un homme et qu'il pouvait "tenir".
Un autre baromètre, tout aussi sûr, était l'énergie quasi-surhumaine qu'il fallait déployer pour aller se laver, malgré la fatigue, malgré les coups qui pleuvaient de toutes parts, malgré le froid glacial. Celui qui un jour, puis deux, ne se lavait plus, ou se lavait irrégulièrement, était entraîné sur la pente fatale et irréversible de la déchéance qui menait à la chambre à gaz.
Sans doute le hasard ou le destin jouaient un grand rôle dans cette vie concentrationnaire où, à chaque pas, cent fois par jour, on risquait la mort. Certes, la maladie et l'épuisement physique ont eu raison de bien des camarades : René Hirschler a tout supporté, a tout enduré pour finir par succomber quelques jours après la libération ! Mais les qualités intrinsèques de l'homme, l'intelligence, la volonté, le courage, la foi ont été souvent déterminants.
La foi ? D-ieu à Auschwitz ? Comme on comprend l'embarras, la gêne, la perplexité de nos penseurs, de nos théologiens cherchant à échafauder hypothèses et théories : "le silence de D-ieu" ou "l'absence de D-ieu" ou encore "l'éclipse de D-ieu". Mais là n'est pas mon propos. Comment a évolué la foi du déporté, dans la mesure où il l'avait, pendant et après sa déportation ? Je ne dispose d'aucune statistique, ni d'aucune enquête à ce sujet. Là encore n'est pas mon propos.
J'apporte mon témoignage strictement personnel et il n'a de valeur précisément que parce qu'il constitue un témoignage. En voyant là-bas, comment des créatures de D-ieu anéantissaient d'autres créatures de D-ieu, en subissant la brutalité toute gratuite, le sadisme raffiné, la cruauté perverse d'hommes civilisés, ayant reçu une éducation familiale, souvent religieuse, une instruction, en constatant chaque jour et à chaque instant, des injustices particulièrement criardes, je me posais forcément des questions.
Je voyais souffrir et mourir autour de moi, avec une apparente égale et révoltante iniquité, l'agnostique et le croyant, l'homme simple et l'homme cultive, l'homme de bien et l'homme de peu. Je me disais : comment D-ieu peut-il tolérer cela, comment peut-Il laisser faire, comment peut-Il supporter cette vision ?
Mais à aucun moment, et je voudrais insister sur ce fait d'expérience, je n'ai eu le sentiment d'une "absence de D-ieu". Après tant d'années, je me sens encore aujourd'hui bouleversé par cette constatation. Logiquement, d'une logique humaine, Auschwitz devait conduire à la négation de D-ieu et ce fut certainement le cas pour la plupart. Ce ne fut pas le cas pour moi, ni là-bas, ni après mon retour. Ma foi s'est trouvée renforcée, raffermie. Est-ce parce que j'ai miraculeusement échappé à une mort qui paraissait certaine ? Je ne le pense pas.
Est-ce par intuition ou par raisonnement ? La foi est irrationnelle mais on peut en sonder les origines. Je crois que ma réaction est à rattacher à ce sentiment fondamental qui m'a dominé tout au long de ma déportation : la stupéfaction, l'incompréhension, le refus d'y croire malgré l'évidente réalité. Combien de fois ai-je murmuré : "ce n'est pas possible, je rêve, il y à quelque chose qui m'échappe".
Et je crois que, précisément, jetouche là le très profond de mon introspection : j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose qui m'échappait ; de même qu'il y a aujourd'hui encore quelque chose qui m'échappe et je pense qu'à propos d'Auschwitz il y aura toujours quelque chose que nous n'arriverons pas à saisir ni à comprendre.
Je sais et je sens que si j'avais passé outre, que si je passais outre aujourd'hui, si je me contentais des multiples explications d'ordre politique, économique, sociologique, psychologique, philosophique de l'événement, j'aboutirais à un grand vide, le vide tragique d'un monde sans D-ieu, livré à lui-même, sans finalité, sans éthique, sans spiritualité. Le monde n'aurait plus de sens, l'homme perdrait toute valeur, la vie ne mériterait plus d'être vécue. Qui sait si ce n'est pas cela, sciemment ou inconsciemment, qui m'a soutenu, qui m'a permis de tenir et qui, à mon retour, m'a permis de revivre.
Oui, je me souviens que j'avais ce sentiment de la présence de D-ieu, mais d'une présence insolite d'un D-ieu incompréhensible, le sentiment d'un phénomène, d'un cataclysme hors de l'entendement humain, dont l'origine, la finalité et la réalité même m'échappaient et me dépassaient. Mais, directement ou indirectement, se rattachait à cette perception et à cette conception, un surprenant optimisme. Je voyais pourtant autour de moi mes camarades dépérir et je sentais mes propres forces décliner. L'hiver était rude et long en Pologne.
Nous étions sous-alimentés, maltraités et le moindre incident de santé terrassait notre organisme : un coup de froid, un trop grand effort dans un kommando trop dur, un coup reçu à une mauvaise place, et c'était la mort certaine. Par ailleurs, malgré les bonnes nouvelles du front recueillies à l'usine par des travailleurs étrangers ou glanées dans de vieux journaux, nous n'avions guère d'illusions : certes l'armée russe avançait, certes les alliés avaient débarqué, mais nous avions l'intime conviction, sinon la certitude, que jamais les S.S. ne nous laisseraient en vie le jour où ils seraient obligés de se replier.
Logiquement il n'y avait aucun espoir. Nous disions entre nous que l'avance des russes annonçait notre fin et nous savions aussi que tout retard la provoquerait. Alors ?
Oui, nous le disions, mais au fond de nous-mêmes, nous n'arrivions pas à y croire vraiment et, contre l'invraisemblable, contre la logique et le bon sens, nous conservions intacte au très-fond de nous-mêmes, une réserve inépuisable et inexplicable d'optimisme.
Et cela aussi nous a permis de "tenir".
.jpg)
René Weil



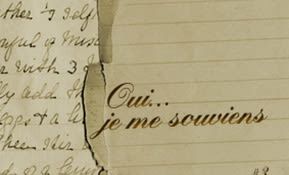


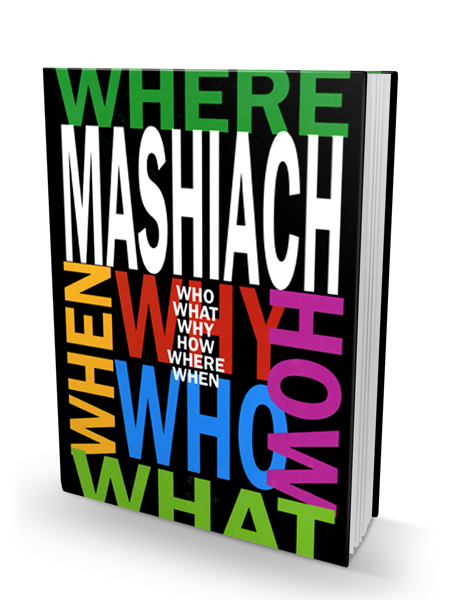



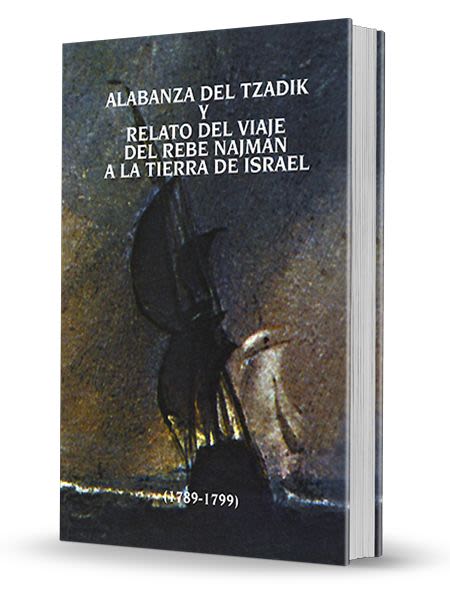

Ecrivez-nous ce que vous pensez!
Merci pour votre réponse!
Le commentaire sera publié après approbation