
Pessa’h Chéni, 1945
Nous entendîmes la paille qui nous cachait d'être remuée. Lorsque nous réalisâmes que les allemands étaient sur le point de nous découvrir, nos âmes furent près de nous quitter.

Pess’ah Chéni (le “deuxième Pessa’h”. À l’époque du Temple de Jérusalem, les juifs qui étaient impurs le jour de Pessa’h, observaient Pessa’h Chéni un mois plus tard) est – cette année 2010 – le 28 AVRIL. Ce qui suit est l’histoire d’un Pessa’h Chéni très spécial d’un survivant des camps, en 1945.]
Le mercredi 25 avril 1945, les gardiens SS du camp de Kaufering ont disparus.
Les superviseurs de notre camp – un camp satellite de Dachau – s’arrêtèrent de nous battre et de nous insulter. Ils savaient que le bruit des détonations des alentours était devenu de plus en plus fort et que cela signifiait les affres de la mort pour le troisième Reich. Ceux parmi nous dont les jambes pouvaient encore les porter envahirent la cuisine du camp et se saisirent des quelques aliments qui y restaient : pommes de terre, farine, choux, morceaux de pain.
Un jour prochain, nous aurions été tués sur le champ pour avoir commis une faute bien moins grave que celle-ci. Cependant, ce jour-là – après plusieurs passés jours sans rien manger – notre faim était plus forte que notre peur. Nous remplaçons nos maigres ventres et nos poches.
Soudainement, le silence qui régnait dans le camp fut brisé par les voies familières et meurtrières de nos ravisseurs allemands.
« Tout le monde en ligne ! Recensement ! Recensement !” En un rien de temps, les assassins étaient de nouveaux occupés – avec l’aide de bâtons et de revolvers – à chasser, tirer et frapper toutes les personnes qu’ils pouvaient, enfin de les faire sortir des baraques. Cela faisait maintenant plusieurs années que je faisais partie d’un groupe de jeunes hassidiques gour de la ville de Lodz (Pologne) ; nous essayons de rester tous ensemble. Nous discutâmes de la situation.
Il était évident que les forces alliées étaient proches du camp. Selon la rumeur, le commandement SS avait ordonné aux commandants de notre camp d’exterminer tous les détenus, afin de ne laisser aucun témoignage vivant possible aux forces alliées. Nous avions de la difficulté à croire à un tel plan diabolique, mais six années passées sous le joug nazi nous avaient enseigné que les prophéties les plus terribles avaient souvent tendance à se réaliser.
Nous débattîmes des choix qui s’offraient à nous. Devions-nous suivre les ordres et évacuer le camp ou devions-nous risquer de rester derrière et attendre les forces alliées ? Nous décidâmes de rester dans le camp et un après l’autre, nous nous faufilèrent dans le bloc des malades atteints de la dysenterie, un lieu où seulement les personnes malades et sans espoir se trouvaient. Nous espérions que les gardiens du bloc choisiraient de ne pas pénétrer dans ce bloc contaminé.
Cependant, notre espoir fut de courte durée, lorsque nous vîmes la porte d’entrée être littéralement brisée par un officier SS – sa mitraillette à la main – criant : “Tout le monde dehors ! Le camp va bientôt exploser !” Un silence répondit à ses cris. Noue ne bougeâmes pas ; le nazi quitta les lieux et la nuit tomba rapidement.
Soudainement, retentit le bruit des sirènes hurlantes. Les alliés bombardaient la défense allemande ! Nous priâmes pour que les explosions étourdissantes puissent durer pour toujours. En fin de compte, nous nous endormîmes au son merveilleux des sirènes et des bombardements.
Le lendemain matin, nous nous réveillâmes dans un sinistre silence interrompu seulement par le gémissement des mourants. Nous nous levâmes prudemment et nous sortîmes de notre bloc. Peu importe où nous regardions, ce que nous voyions était un spectacle de désolation totale. Nous aperçûmes également un trou béant dans la barrière en barbelé du camp. Avait-elle était ouverte pas les allemands qui étaient en train de fuir ? Étions-nous libres ?
Nous nous rendîmes aux baraques voisines de la nôtre. Nous partageâmes notre découverte avec les quelques personnes terrifiées qui restaient encore dans ces baraques ; tous étaient de véritables squelettes avec encore un brin de vie qui ne désirait pas les quitter. Quelques minutes plus tard, nous entendîmes le grondement indubitable d’un convoi qui approchait. Nous nous assirent et attendirent ; notre état était lamentable, mais nous attendions tous avec excitation de voir qui allait surgir dans le camp.
Notre attente tourna à la frayeur lorsque nous virent des uniformes SS entrer dans le camp. Nous espérions voir les forces alliées et notre déception était grande. Les nazis étaient revenus et avec eux, se trouvait un détachement entier de prisonniers des camps environnants afin de les aider dans leur travail. Parmi l’immense vacarme causé par les cris et les obscénités de toutes sortes, nous nous dépêchâmes de nous cacher dans une des baraques en nous couvrant de paille et des haillons qui restaient sur place. Nos cœurs étaient écrasés par la terreur.
Rapidement, nous entendîmes les pas de plusieurs personnes dans la baraque et je sentis une main se poser sur ma tête. Nous venions d’être découverts par les détenus non juifs et les prisonniers de guerre des autres camps.
Nous les suppliâmes d’ignorer le fait qu’ils nous avaient découverts. Nous leur offrîmes les pommes de terre que nous avions prises dans la cuisine. À l’instant où ils nous dirent qu’ils étaient d’accord, un officier SS entra d’un pas lourd – en balançant un bâton dans ses mains – et il se mit à nous frapper sur la tête d’une façon efficace et sans merci. À force de coups de pied, nous furent amenés près des camions, le tout sous la surveillance étroite des commandos et des SS.
Nous fûmes soulevés par les bras et les jambes et jetés dans les camions. Le résultat fut un tas de corps qui ressemblaient vaguement à des humains entassés les uns sur les autres. Le gémissement des malades alternait avec le silence des morts. Avec un coup de chance extraordinaire – tandis que les gardiens étaient occupés avec un autre camion – mon ami Yossel Carmel et moi-même pûmes nous laisser glisser à l’extérieur du camion ; nous nous réfugiâmes immédiatement dans les latrines voisines.
Même si nos cœurs été devenus durs comme de la pierre depuis longtemps, l’odeur qui régnait retournait notre estomac.
En fin de compte, les camions quittèrent le camp. Nous nous faufilâmes de nouveau dans la même baraque où nous avions trouvé refuge précédemment. Je brisai la lampe qui était encore éclairée au plafond et nous nous immobilisâmes, essayant d’une manière peu convaincante de jouer le rôle de cadavres. À plusieurs reprises, la porte s’ouvrit et nous entendîmes : “Tout le monde dehors !” Cependant, nous ne bougions pas. L’obscurité envahit la baraque, les moteurs grondèrent et le silence régna en maître.
Le vendredi 27 avril 1945 fut un matin particulièrement froid. Des nuages blancs se couraient les uns après les autres et le ciel bleu et clair laissait souffler un vent frigide à l’intérieur des baraques. Nous sentions le froid intense jusqu’à l’intérieur de nos os. Régulièrement, la terre tremblait avec une explosion ; nous nous assîmes tranquillement, chacun étant absorbé dans ses pensées. Soudainement, nous entendîmes gronder le bruit de motocyclettes et des chiens aboyer. Nos cœurs sombraient de nouveau : les allemands revenaient, une fois de plus.
En quelques instants, des bruits de pas envahirent la baraque et une voix frénétique hurla : “Porcs ! Vous attendez les américains ? Suivez-moi !” Il s’ensuivit une agitation importante, un bruit de personnes qui courent, des bris de verre et ensuite, la rafale d’une mitraillette. Je jetai un coup d’œil et vis que ceux qui s’étaient cachés près de la fenêtre avaient essayé de s’échapper.
Yossel et moi-même n’avions pas été détectés, mais nous étions littéralement paralysés par la peur. Les bruits de pas se rapprochèrent de nouveau et nous entendîmes la paille qui nous cachait être remuée. Lorsque nous réalisâmes que les allemands étaient sur le point de nous découvrir, nos âmes terrifiées furent très près de nous quitter.
Nous retinrent notre respiration, terrifiés pas la peur. Soudainement, nous entendîmes que les pas s’éloignaient. Jetant un coup d’œil à travers la paille qui me couvrait, je sentis la fumée envahir mes yeux. Pris par un sentiment de démence, nous repoussâmes la paille et les torchons qui se trouvaient au-dessus de nous : nous vîmes des flammes de partout. Main dans la main, Yossef et moi-même tâtonnèrent le sol en nous dirigeant vers la porte.
Nous suffoquions à cause de la fumée et nous pensions qu’un instant à l’autre, nous allions perdre connaissance. Après quelques secondes – qui nous semblèrent une éternité – nous nous retrouvâmes à l’extérieur. Nous étions seulement à quelques mètres des assassins allemands, mais nous avions de la chance : ils nous tournaient leur dos.
Le camp entier était en flammes. Nous nous jetâmes sur le premier tas de corps que nous virent et restèrent immobiles. Nous n’avions aucun doute sur le fait que nous ressemblions d’une façon parfaite à notre camouflage. Autour de nous, nous entendîmes le bruit lourd de bottes, de cris et de gémissements de ceux qui étaient en train de mourir. Tout ce que nous voyions était sang, feu, nuages et fumée : un véritable enfer sur terre, avec la présence de ses démons.
Lorsque le silence régna de nouveau, je marmonnais à Yossel que nous devions dire la prière de Vidouï, la confession des péchés que prononcent régulièrement les juifs, mais aussi lorsqu’ils ont fait face à la mort. Il me réprimanda pour ne pas me souvenir ce que je lui avais dit le jour où nous pénétrâmes dans le camp d’Auschwitz, le premier camp où nous restâmes.
Les Sages du Talmud – me rappela-t-il – nous ont averti : “Même si une épée est placée sur votre cou, ne désespérez jamais de la Merci divine.” Yossel se souvenait également que les Sages nous avait dit qu’en cas de danger, les juifs devaient renouveler leur obligation envers leur foi.
Nous rampâmes vers une fosse voisine, tremblants de froid. Mes yeux étaient encore remplis de fumées et je tremblais toujours de la peur récente que j’avais eue. J’avais l’impression que nous étions entourés de gardiens SS et qu’ils pointaient leurs armes sur nous. Cependant, Yossel réussit à me convaincre qu’il n’y avait strictement personne autour de nous.
Pour plus d’une heure, nous nous étendîmes au fond de cette fosse. À chaque instant, nous entendions le bruit des bombes voler au-dessus de nous, suivi du bruit étourdissant de leur explosion. La terre tremblait, mais chaque nouvelle détonation injectait un nouvel espoir en nos cœurs. Doucement, nous sortîmes de la fosse et nous firent notre chemin vers le seul bâtiment qui restait encore debout : la cuisine du camp. Dans ce bâtiment, nous trouvâmes d’autres âmes aussi épeurées que les nôtres.
Bientôt, un sac de farine fut découvert dans la cuisine. Nous le mélangeâmes avec de l’eau, nous allumèrent les fours et nous firent cuire des galettes. L’ironie de notre sort surgit dans mon esprit : nous étions Pessa’h Chéni – le deuxième Pâques biblique, un mois après le premier – et nous étions en train de faire cuire des matsoth !
Soudainement, la porte sembla s’envoler. Un compatriote juif entra en courant et à bout de soufflé il s’écria : “Juifs ! Les américains sont arrivés !” Nous étions libres.
Nous désirions tellement pleurer, chanter, danser ! Cependant, nos cœurs étaient pétrifiés et il était impossible de leur redonner vie. Je désirais courir vers l’extérieur, mais mes forces m’avaient quitté.
Lorsque je parvins finalement à sortir, je vis un long convoi de tanks et de jeeps mugir à travers tout le camp. Une poignée de soldats américains s’approcha des baraques. Un des soldats – un officier – regarda autour de lui ; des larmes se mirent à couler sur son visage. C’est seulement à cet instant que je saisis parfaitement l’étendue de l’horreur qui nous entourait. Les baraques avaient presque entièrement brûlé. Devant chacune d’elles, se trouvait un tas de squelettes noircis par le feu.
Je faisais partie des vivants, avec un groupe de fantômes errants, de véritables corps qui marchaient. Avec les soldats américains, nous commençâmes à pleurer.
Parmi les provisions que les américains avaient apportées avec eux, se trouvait une bouteille de vin. Un des survivants la prit et s’écria : “Je n’ai pas récité le Qidouch depuis des années ! Aujourd’hui, je dois le faire.” Immédiatement, il récita les mots de la bénédiction sur le vin.
Ensuite il récita la bénédiction de Chehé’héyanou, la bénédiction de remerciement envers D-ieu pour nous avoir “gardés en vie jusqu’à ce jour.”
***
[I.I. Cohen – juif polonais qui a survécu aux camps de concentration – vit à Toronto. Cet article est extrait du livre qu’il a écrit à propos de son expérience.]





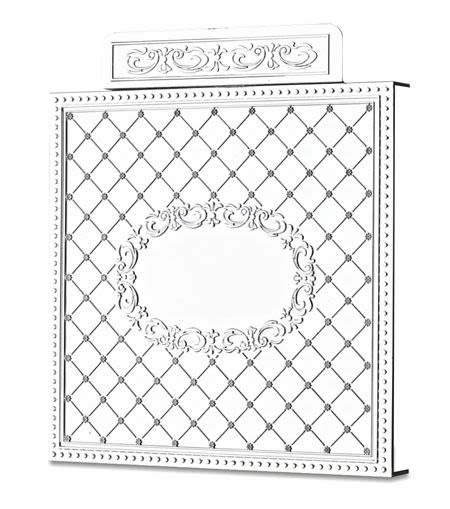
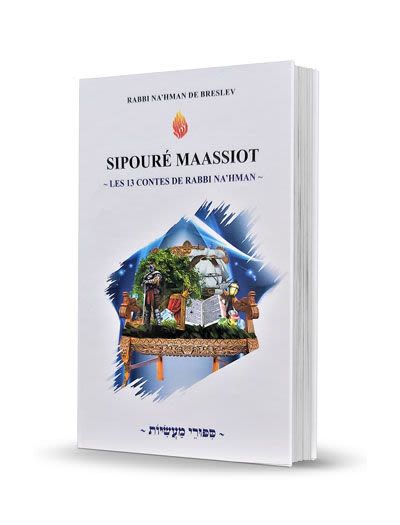


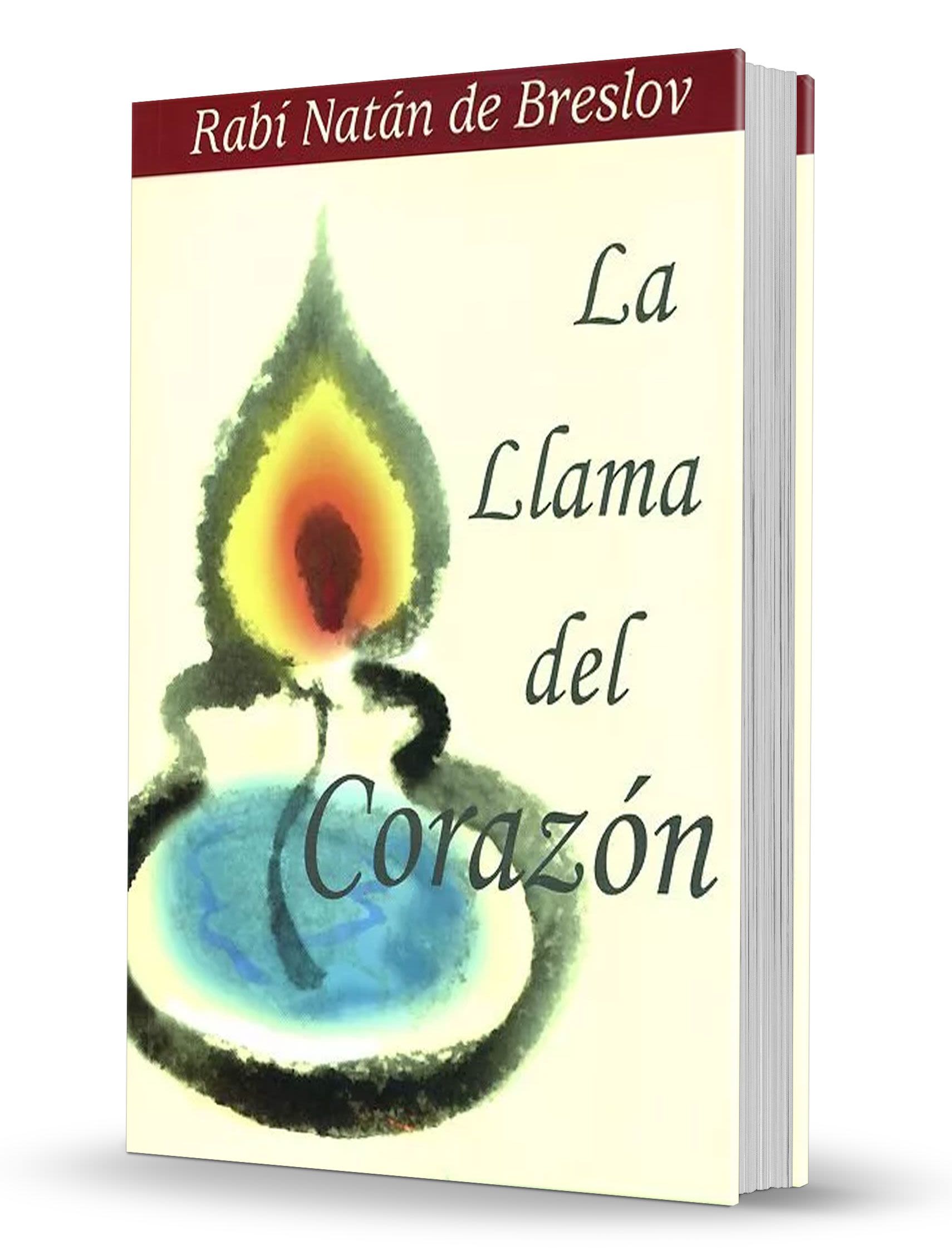

Ecrivez-nous ce que vous pensez!
Merci pour votre réponse!
Le commentaire sera publié après approbation